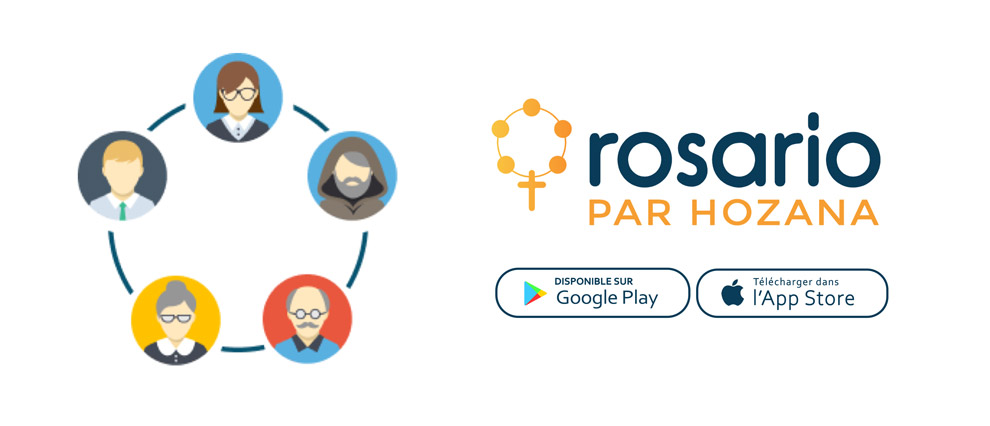Qu'est-ce que la méditation vipassana ?
Au cœur des traditions orientales les plus anciennes, la méditation Vipassana se présente comme un chemin de purification de l’esprit par l’observation attentive et silencieuse de ce qui est. Née il y a plus de deux mille cinq cents ans en Inde selon les enseignements du Bouddha, cette pratique vise à voir les choses telles qu’elles sont, en cultivant une conscience fine et équanime (détachée et sereine) des sensations, pensées et émotions qui traversent l’être. Loin de toute recherche de performance, Vipassana repose sur une méthode rigoureuse et exigeante qui invite à l’expérience directe, à la patience et à l’ancrage dans le moment présent. Alors qu’elle est devenue très populaire actuellement au sein des différents types de méditation, explorons les origines, les fondements de cette voie millénaire et les grands principes de sa méthode, telle qu’elle est transmise aujourd’hui dans les retraites intensives de dix jours.
Origines et fondements
La méditation Vipassana, dont le nom signifie « vision pénétrante » ou « vue profonde », est une pratique fondamentale du bouddhisme, particulièrement dans la tradition theravāda. Elle vise à développer une compréhension directe et profonde de la réalité en observant avec attention les phénomènes corporels et mentaux, afin de percevoir les trois caractéristiques de l’existence : l’impermanence, la souffrance et l’absence de soi. Formalisée dans des textes anciens, elle s’appuie sur une concentration préalable (samatha) pour stabiliser l’esprit, avant de cultiver une observation fine et indifférente de ce qui se passe à l’intérieur de soi…
Les origines de Vipassana remontent à l’Inde ancienne, plus de cinq siècles avant notre ère, au temps du Bouddha Siddhartha Gautama. Selon la tradition, Vipassana est initiée par le Bouddha lors de son éveil et transmise comme une méthode de libération de la souffrance. Pratiquée pendant des siècles, elle finit par se perdre en grande partie, sauf dans certains courants du bouddhisme Theravāda, notamment en Birmanie, où elle est préservée par des lignées monastiques. Au XXe siècle, cette tradition méditative est réintroduite dans le monde contemporain par des maîtres comme Ledi Sayadaw, Mahasi Sayadaw, et surtout S.N. Goenka, qui en fait une méthode accessible à tous, indépendamment de toute appartenance religieuse.
Vipassana aujourd’hui
Selon son témoignage, Goenka, un homme d’affaires birman important, souffrait de maux de tête que rien de soulageait, jusqu’à ce qu’il se laisse convaincre d’essayer la méditation Vipassana. Au bout d’une retraite, il est totalement guéri. Après s’être perfectionné auprès du maître birman U Ba Khin dans les années 60, il commence à enseigner en Inde où il remporte un vif succès, ses cours étant accessibles à tous dans un pays dominé par les divisions de castes et de religions. Peu à peu, des occidentaux accourent au centre indien et Goenka forme des assistants-enseignants à partir du début des années 80, qui vont alors essaimer à travers la planète, construisant de nouveaux centres partout dans le monde. Aujourd’hui, 256 centres enseignent la méditation vipassana dans le monde.
Pratiquée dans le monde entier, essentiellement dans des contextes laïcs, thérapeutiques ou carcéraux, elle continue d’être considérée comme une voie de libération intérieure profonde, bien que ses effets bénéfiques sur le bien-être soient aussi étudiés par la science contemporaine.
La méditation Vipassana a été introduite pour la première fois en milieu carcéral en 1975, à la prison centrale du Rajasthan. Son implantation dans la prison de haute sécurité de Tihar, à New Delhi, à partir de 1994, a marqué un tournant significatif. Le succès rencontré a conduit le ministère de l'Intérieur indien à recommander l’intégration de cette pratique dans l’ensemble des établissements pénitentiaires du pays, comme outil de réforme. Inspirées par cette initiative, plusieurs expériences similaires ont vu le jour dans les prisons d’Israël, du Canada, de Colombie, de Taïwan, du Royaume-Uni, d’Espagne, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis et du Mexique.
La méthode Vipassana
L’enseignement Vipassana se résume en 3 mots : la moralité ; sila, la concentration ; samadhi et la sagesse ; pañña. Pendant les retraites de dix jours, 5 préceptes sont à respecter, comme celui de ne pas tuer (nourriture 100% végétarienne), de ne pas prendre ce qui n’est pas donné (gratuité du cours), ne pas prendre d’intoxicants. Pour la concentration, le noble silence est demandé. Il s’agit de se passer de paroles et de contacts visuels avec les autres méditant(e)s. Il est aussi interdit de lire et d’écrire.
Une journée type se déroule ainsi : lever à 4h, puis méditation de 4h30 à 6h30 dans une grande salle avec les autres méditants (en France, le Dhamma Hall du centre Vipassana accueille une centaine de personnes). Les hommes et les femmes sont séparés. Puis vient le moment du petit-déjeuner. Le reste de la journée se déroule entre des méditations (une dizaine d’heures par jour) entrecoupées de deux pauses, un déjeuner à 11h et un goûter à 17h. Il n’y a pas de dîner, jusqu’à l’extinction des feux à 21h30.
Les retraites sont uniquement financées par les dons des étudiants ayant fréquenté les cours.
Qu’en pense le christianisme?
Un jésuite a adopté la méditation vipassana au Japon l’intitulant “Méditaiton vipassana chrétienne”. Il a constaté que les japonais, qui ont “une manière de réfléchir beaucoup plus orientée vers l’intégrité du corps et de l’esprit ”, éprouvaient des difficultés à cultiver l’esprit de détachement nécessaire pour les exercices ignatiens, qui ont été conçus pour les occidentaux ayant une manière de réfléchir plus intellectuelle. C’est ainsi que le jésuite Toshihiro Yanagida rapporte que “cette forme de méditation apporte la paix à l’esprit dans une situation de stress et peut libérer de différentes souffrances et anxiétés mentales”.
De manière globale, on peut dire que la méditation Vipassana, d’un point de vue spirituel, repose sur des concepts comme l’absence de soi et l’impermanence, qui diffèrent de la vision chrétienne de l’âme et de la relation personnelle avec Dieu. Toutefois, certains courants chrétiens contemplatifs voient des affinités spirituelles possibles, à condition de rester fidèle à la foi chrétienne. Il ne semble pas y avoir d’opposition entre vipassana et christianisme à partir du moment où cette forme de méditation est utilisée comme une observation neutre du mental à des fins de nettoyage psychologique ou pour apporter le calme à l’esprit. Il est évident qu’il y a incompatibilité si on l’utilise à des fins spirituelles.
L’Église catholique, dans un document publié par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en 1989 (Lettre sur certains aspects de la méditation chrétienne), met en garde contre l’adoption non critique de méthodes spirituelles venues d'autres traditions, qui pourraient détourner le croyant de la révélation chrétienne ou du sens personnel de la prière. Elle insiste sur le fait que la méditation chrétienne est avant tout une rencontre avec une personne vivante — le Christ — et non une recherche d’absorption impersonnelle ou de vide intérieur.
La méthode Vittoz : une voie chrétienne pour harmoniser son être et s’ouvrir à Dieu
Meditatio, première application de méditation chrétienne, vous invite à découvrir la méthode Vittoz. Cette approche psychocorporelle favorise une présence attentive à votre corps et à votre environnement, tout en vous rapprochant de Dieu par une pratique nourrissante de la prière. Découvrez cette méthode à travers un programme dédié sur l’application Meditatio !
- https://mahi.dhamma.org/fr/
- https://www.jesuits.global/fr/2022/08/05/meditation-vipassana-chretienne/#:~:text=Du%20point%20de%20vue%20du,si%20elles%20sont%20très%20négatives.
- https://chilowe.com/articles/meditation-retraite-vipassana-experience/?srsltid=AfmBOoqOxOBOHEf2qIIvx2_mYMEE_MW3bQOQqHTjUEsfudUCYyKiLOO6